Rodolphe Landemaine : se réinventer

Rodolphe Landemaine revient, dans cet échange dense et personnel avec Thérèse Lemarchand, sur les trois grandes bifurcations qui ont marqué son parcours : de la création d’un empire de la boulangerie à la prise de conscience écologique, jusqu’à une transformation intérieure guidée par la quête d’alignement et de sagesse.
Entre ambition stratégique, renoncements assumés, introspection profonde et reconnexion au vivant, Rodolphe Landemaine partage une vision lucide et exigeante du monde, du rôle de l’entrepreneur, et de ce que signifie aujourd’hui "réussir". Une parole puissante, ancrée dans l’action comme dans la réflexion, qui invite à repenser nos récits, nos modèles, et notre rapport au temps, à l’argent et au vivant.
Interview réalisée le 2 Avril 2025 par Thérèse Lemarchand
Bonjour Rodolphe, tu es fondateur des boulangeries Maison Landemaine et Land&Monkeys, de Yumgo, et d’un fonds de dotation actionnaire - Domaine Sauvage du Costil. Nous allons approfondir cela 🙂
Dans un premier temps peux-tu nous parler des pivots clés qui t’ont amené à cet “empire” de la boulangerie - pâtisserie
Rodolphe Landemaine : il y a eu plusieurs changements fondamentaux au cours de ma vie. J’ai toujours ressenti une attirance naturelle pour les sciences, la connaissance du fonctionnement du monde. J’avais adolescent un intérêt marqué pour l’étude des animaux, l’éthologie, l’archéologie… Je n’avais pas de projet précis, mais j’avais naturellement choisi un bac scientifique pour explorer cette voie.
En parallèle, je viens d’un milieu très modeste. Enfant, nous ne partions jamais en vacances, ni moi ni ma sœur, et cela m’a profondément marqué. J’ai grandi avec une forme de revanche sociale, une envie de m’élever.
J’avais donc cette dualité en moi entre une vocation certaine et détachée du matériel, et mon héritage socio-culturel, qui faisait que je cherchais une forme d’émancipation.
Intuitivement, l’idée de créer une entreprise s’est imposée. J’aspirais à la liberté. Mais le monde de l’entreprise m’était alors très lointain. Ce n’était ni un sujet familier ni particulièrement accessible : j’ai grandi à la campagne, en Normandie, avec un père militaire et une mère au foyer. Il me fallait tout découvrir par moi-même.

1J’ai donc fait un choix assez classique : la boulangerie.
Je me disais que ce métier traverserait les époques, que les gens auraient toujours besoin de pain. Ce fut ma première bifurcation après le bac : quitter le parcours académique pour apprendre un métier, avec l’idée simple d’ouvrir un jour ma propre entreprise et de la faire grandir — sans rien connaître, à ce stade, du monde entrepreneurial.
Première bifurcation donc, devenir entrepreneur, à une époque où cela se faisait très concrètement avec de la matière. Quelle a été ta deuxième bifurcation ?
Ma deuxième bifurcation fut liée à l’élaboration d’un plan. J’ai toujours eu une fibre stratégique et c’est sans doute ma force. J’ai prévu ce virage : faire fortune d’abord, puis amorcer un basculement de vie. Car cette première étape, purement économique, n’était pas une vocation. Je pressentais autre chose, quelque chose de plus vaste.
Je m’étais fixé 45 ans comme cap : travailler intensément jusque-là, puis me réinventer. J’ai toujours été très sensible au temps qui passe, et je tenais à continuer d’expérimenter. Ce choix me laissait le temps de bâtir une entreprise solide, tout en gardant l’énergie nécessaire pour une nouvelle aventure.
Je ne pense pas en termes de longévité, mais de vie en bonne santé — pour moi, l’horizon, c’est 60-65 ans, pas 80. Je ne voulais pas finir en pilote automatique, à regarder croitre une boîte florissante dont j’aurais délégué la gestion. J’ai toujours admiré celles et ceux qui osent un grand virage, qui se reconstruisent : c’est vertigineux, mais profondément vivant.
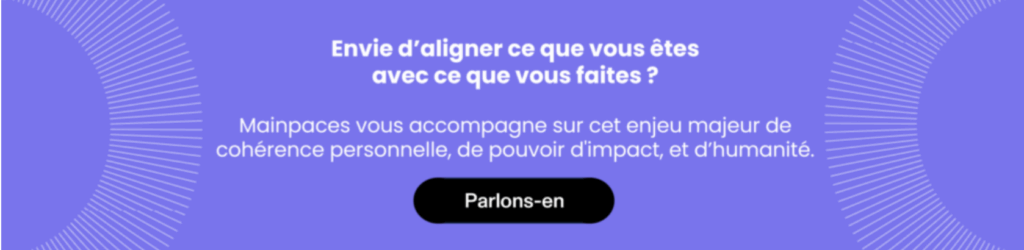
Rodolphe Landemaine : du succès matériel à la conscience écologique
Rodolphe Landemaine, deuxième tournant : avoir un plan pour pouvoir se réinventer à 45 ans. Comment s’est-il réalisé et qu’a-t-il emmené avec lui ?
Mon troisième basculement, plus radical. J'ai basculé vers autre chose quand j'ai pris conscience il y a une dizaine d’année des enjeux écologiques et des grands problèmes du XXIe siècle. C'est peut-être le point pivot qui a été le plus violent pour moi.
J’avais « réussi » : une entreprise prospère, la Porsche, les voyages en business class, des appartements à Paris et à l’étranger, des interventions dans le monde entier. Mais cela ne me ressemblait pas. Au fond, je suis un homme d’idées, de réflexion. J’étais déjà végétarien et je deviens végan.
Et là, par la porte du véganisme, je découvre tous les sujets de limites planétaires, d'effondrement de la biodiversité, de dérèglement climatique.
Je lis tout ce que je peux sur le collapse, sur cette idée que l’humain est devenu une force géologique destructrice. Le choc est profond : j’ai sombré dans une dépression.
Je me suis vu comme partie prenante du problème — un homme riche et inconséquent.
Ce fut le début d’une profonde introspection. J’ai traversé toutes les phases du deuil2 : déni, colère, tristesse… avant de me détacher de cette vision du monde. J’ai revu ma manière de vivre, de consommer, de me nourrir. J’ai arrêté l’avion, embrassé une autre typologie de vie, amorcé une véritable dématérialisation.
Renoncer à tout cela, c’est aussi se remplir autrement. Ce sont des vases communicants. J’ai commencé à chercher des réponses plus spirituelles : pourquoi je vis, à quoi je sers, comment trouver un équilibre sans pour autant vouloir être un héros. Comment contribuer à l’intérêt général en restant aligné, sans m’effacer du monde.
Ce cheminement a pris près de dix ans. Les réponses ne viennent pas vite. C’est une descente, parfois douloureuse, mais suivie d’une remontée au fil des lectures, des expériences, de la reconnexion au vivant. C’est là que j’ai découvert mon ikigai3, ce croisement entre ce que je sais faire, ce que j’aime, ce dont le monde a besoin, et ce qui me rend utile.
Moi, je sais créer de la valeur. Mais ce que j’aime profondément, c’est la nature, le vivant. Mon attachement à l’éthologie, à l’altérité, aux animaux, tout cela m’habite depuis toujours.
Mon ambition aujourd’hui est de mener des projets qui, comme le disait Camus, tentent de faire en sorte que le monde ne se délite pas.
Mais trouver sa voie, c’est aussi accepter la solitude et le renoncement. On perd des amis, des repères. On sort des normes. Il faut avoir la force de renoncer, et c’est ce que beaucoup de gens ont du mal à faire. Non pas par manque d’intelligence, mais par peur de choisir. Choisir, c’est renoncer. L'être humain a beaucoup de mal à renoncer.
Je pense que cette vision à moyen et long terme manque souvent aux gens. Ce n’est pas une question de capacité ou de pertinence, c’est vraiment le sujet de la projection. A partir du moment où tu matérialises un plan, tu es obligé de te préparer à renoncer.
Beaucoup veulent poursuivre plusieurs directions en parallèle, sans renoncer. Mais cela ne fonctionne pas. Il faut décider de ce à quoi on destine sa vie. Il faut conscientiser que quand tu te focalises sur les affaires, tu vas donner 10 - 15 des belles années de ta vie, où tu vas travailler 16 heures par jour. Si tu n’as pas cette conscience, tu ne peux pas bifurquer. C’est aussi pourquoi je m’étais donné une limite à 45 ans : pour me laisser la possibilité de vivre autre chose, pleinement.
Qu'est-ce que t'as eu le plus dur à dépasser sur ce chemin-là ?
Le plus difficile pour moi a été d’accepter que je puisse devenir autre chose que ce pour quoi j’ai été conditionné. Dépasser les plafonds de verre, c’est reconnaître qu’une transformation est possible — et ça, c’est profondément déstabilisant.
Je suis passionné par Jung, et je crois que l’enjeu, c’est d’aligner l’inconscient et le conscient. Si tu dis vouloir être riche mais que, profondément, tu veux juste être heureux, alors tu vis un tiraillement constant. Ce n’est pas une question d’affirmation. C’est une question d’incarnation, et ça demande du courage. On peut ressentir un fort sentiment d’imposture, de trahison presque : « mes parents étaient modestes, pourquoi deviendrais-je quelqu’un d’autre ? ».
Il y a une forme d’absurdité : quand tu demandes aux gens leur rêve, ils évoquent souvent des choses simples, à portée de main — « faire le tour du Japon » —, mais qu’ils ne réalisent jamais. Et quand tu leur demandes pourquoi, un silence s’installe. Parce qu’en réalité, ils viennent de réaliser qu’ils le pouvaient.
S’approprier son rêve, c’est admettre qu’on est capable de devenir cette autre version de soi-même.
Et ça, c’est vertigineux.

Donc, pour toi Rodolphe Landemaine, le travail approfondi a été de créer cet alignement, pour pouvoir dire : ma vision de moi demain n'est pas une utopie. Ce qui a été difficile a-t-il été de tenir ta vision de demain, ou de faire avancer ton Rodolphe d'aujourd'hui ?
Il y a toujours des dualités, je suis maintenant à l’aise avec ça. Nous ne sommes jamais une seule facette, et souvent, on tente de concilier des éléments inconciliables. Il y a l’ombre, la lumière, les contradictions. Comprendre cela mène à une forme de sagesse, proche du stoïcisme : accepter les choses et les failles humaines telles qu’elles sont, sans toujours se poser en justicier ou en figure morale irréprochable.
Il faut aussi savoir regarder sa propre part d’ombre, reconnaître en soi des élans de mensonge, de déloyauté, de colère — autant d’éléments profondément humains. Moi, par exemple, je suis souvent en rage ! La bêtise humaine me met hors de moi. Et pourtant, je suis capable d’intellectualiser, de réfléchir avec distance, de faire des grandes phrases et de citer des philosophes... Je suis donc parfois l’antithèse de ce que je dis, à passer une journée à râler comme un vieux bougon. Puis je retrouve le calme et je me replonge dans mes lectures.
Je crois que cette colère qui m’habite vient aussi de ma lassitude face à notre égocentrisme d’espèce, à cette manie de l’Homme de se croire le centre de tout, la plus belle création de l’univers. C’est épuisant.
Comment crois-tu que l’humanité pourrait évoluer de façon plus juste ?
Je crois aux règles universelles — celles que l’on retrouve dans les sciences naturelles, mais aussi chez les peuples racines ou dans les philosophies orientales : respect du vivant, éthique, sobriété, tempérance... Depuis toujours, les civilisations ont tenté de canaliser les dérives humaines. Mais nous avons échoué à intégrer ces sagesses-là.
L’être humain s’est peu à peu vidé de spiritualité, et c’est peut-être ce qui l’a mené là où il en est. Et pourtant, c’est radical : plus tu dématérialises ta vie, plus tu peux la remplir de sens.
Quand tu te nourris intérieurement, tu n’as plus besoin de combler par la consommation.
Il existe une infinité de cosmologies, de manières d’habiter le monde. Et quand tu trouves un lien à quelque chose de plus grand que toi, l’attachement au matériel devient secondaire.
C’est pourquoi, aujourd’hui, je pense que le vrai danger, c’est le capital. Le remettre en question ne relève pas d’un vote politique, mais d’une posture intérieure.
Comment as-tu rendu cette posture concrète et puissante ?
Je suis un homme d’action, j’ai ressenti le besoin de traduire mes convictions dans le concret.

C’est ce qui m’a conduit à créer le domaine sauvage du Costil4.
Ce lieu m’a permis de me réancrer, de retisser un lien avec un territoire, un écosystème, un environnement — les arbres, les oiseaux, la vie autour de moi… et, par extension, le cosmos.
Le Costil, c’est un projet pilote, un point de départ pour essaimer depuis la Normandie.
Sur le papier, ça peut sembler anodin, mais c’est en réalité une porte vers une autre manière de voir le monde. J’ai pris conscience que nos moindres gestes — cultiver, couper un arbre, retourner la terre — ont un impact. Une fois que tu comprends ça, tu changes ta manière de vivre, d’interagir avec le vivant, tu fais attention. Tu cherches à réduire ton empreinte, à atténuer la souffrance.
Et peu à peu, tu accèdes à d’autres niveaux de compréhension. J’ai compris récemment le rôle des moines, la force de la prière, l’existence d’une connexion invisible entre les êtres, au-delà de ce que l’on perçoit.
Je suis arrivé à cette conviction : tout est lié. C’est devenu mon adage.
Depuis, j’accueille pleinement ce qui ne se voit pas. Pas nécessairement un dieu tout-puissant, mais une force supérieure, une interconnexion subtile, invisible, qui relie tout. C’est vertigineux, mais aussi apaisant. Cela t’enseigne le lâcher-prise. C’est là que les mots de “sagesse” et “équilibre” reviennent sans cesse. Ils étaient le socle des civilisations humaines, et notre modernité les a brisés. En rompant l’équilibre, on a perdu notre sagesse.
Je lis beaucoup René Guénon en ce moment. Il annonçait déjà, il y a un siècle, l’effondrement de l’Occident, conséquence de l’abandon du spirituel au profit du matérialisme. C’est le pacte faustien : s’enrichir en échange de la perte du sens.
Pour lui, nous vivons la fin d’un cycle. Une crise profonde — identitaire, écologique, cosmologique. Mais une crise n’est pas une fin : c’est un passage, une mue. Comme l’adolescence, qui est chaotique, mais nécessaire pour grandir. C’est ce que nous vivons, en tant qu’espèce. Et cela, les philosophies orientales l’ont toujours su. Elles parlent de cycles, de fins et de renaissances. Un jour, quelque chose de plus apaisé renaîtra. Même si on ignore encore ce que ce sera.
Je te rejoins et c’est aussi l’objet de mon livre, Rêver et Agir. Je crois également que cela impose d'avoir une forme d'humilité de notre place dans le vivant. Et par ailleurs un rapport au temps qui laisse la place à l’émergence. Alors la spiritualité permet l’épanouissement de cet espace beaucoup plus vaste de ce que nous sommes et du sens que nous donnons à notre vie, pour guider la manière dont nous vivons la vie.
Oui, tout cela se crée dans des temps longs. Et du coup ton existence n'est pas si importante que ça.

Rodolphe Landemaine : l’alignement en action
Tu as fait un parcours d’accompagnement Mainpaces, qu’est-ce qu’il t’a apporté d’essentiel ?
Le démarrage m’a particulièrement plu : faire cet audit de moi-même, tardivement. Je ne l’avais jamais vraiment fait. Avoir des professionnels pour ce “scan” à l’instant T, c’était très précieux. J’aime explorer et c’est fascinant de se poser pour observer qui l’on est, ici et maintenant.
J’ai aussi beaucoup aimé l’approche globale : le travail sur le corps, l’esprit, mes raisons d’être. Même si j’avais déjà entamé un profond travail personnel, certaines blessures d’enfance restaient là, en filigrane. Ce processus m’a permis de les soigner sans les fuir. Je ne voulais pas tomber dans le déni, je voulais avancer en conscience, plutôt que de m’effondrer alors qu’un burnout couve en silence.
Du point de vue du coaching autour duquel s’articule tout cela, ça a été un vrai accompagnement de performance : ma vision est claire, mes forces comme mes fragilités sont identifiées. Le puzzle mental s’est structuré. Et à chaque session avec Andrée, ma coach, j’ai vécu des moments denses, parce que j’étais présent, engagé. Elle avait cette justesse, cette puissance tranquille pour me challenger, détecter mes faux-semblants, me remettre face à moi-même. Le tout dans un espace de confiance.

A-tu une maxime dans la vie ? Comment se caractérise-t-elle ?
J’ai une foule de maximes. J’adore ces petites phrases qui condensent tout, souvent issues des grands penseurs. La plupart ont raison… mais partiellement. Ce sont des fragments de vérité. Et s’y accrocher seul, comme à un dogme, peut devenir piégeux. Si tu te focalises uniquement sur Kant ou Schopenhauer, tu risques de passer à côté du reste du puzzle.
Ce que j’aime profondément, c’est la tempérance, la subjectivité — même si elle complique parfois les choses. Dans l’entreprise, on doit trancher. Je prends dix décisions par jour. Et cette subjectivité peut freiner, t’empêcher d’être l’entrepreneur qui voit, qui décide, et qui fonce.
Mais moi, ce qui me revient sans cesse, ce sont trois mots : équilibre, tempérance, sagesse. Tempérance face à notre propre démiurgie, comme le disaient les Grecs avec l’hubris : cette tentation de toute-puissance. Il faut sans cesse veiller à ne pas basculer dans l’ombre.
Et puis la sagesse… Ce mot a quasiment disparu de nos vies modernes. Pour moi, vivre, c’est chercher à devenir un peu plus sage, au fil du temps. Et tu le sens chez certaines personnes, jeunes ou âgées : ce calme, cette paix intérieure, cette absence d’agitation. Elles ont passé un cap et ça se voit.
Est-ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais passer à ceux qui nous lisent, à tes comparses entrepreneurs et entrepreneuses ?
Oui, je suis convaincu qu’on sous-estime le bien que cela fait, à soi-même, de faire du bien aux autres. Résultat : on agit, mais avec retenue, comme s’il fallait se méfier d’une démarche trop altruiste. Pourtant, cette pureté d’élan est rare… et précieuse.
J’ai des amis très fortunés. Avec ce qu’ils ont, ils pourraient faire énormément. Mais ils minimisent ce que cela pourrait leur apporter en retour, humainement. Ils restent figés dans le rôle de l’entrepreneur accompli, qui enchaîne les investissements, crée de la valeur… mais sans vraiment savoir pourquoi. Même brillants, ils n’ont pas toujours de réponse claire quand on leur demande la finalité de tout ça.
Moi, aujourd’hui, je suis libéré de ça. Je fais ce que je fais avec joie, et apparemment ça se voit. Ils perçoivent cette paix, et je sens qu’ils ont envie d’y goûter aussi. Il ne manque parfois qu’un petit coup d’épaule. Juste ça. Boum. “Vas-y, quoi, pourquoi te priver de ça ? ».
Je crois comme toi dans cet immense pouvoir du don. Mais je crois que dans cette capacité à donner il y a également un sujet, un changement très radical de mode de fonctionnement, qui est de sortir du transactionnel.
L'instant de l'acte de don est un cœur à cœur avec la personne, avec ton geste, avec ton action. Alors il prend toute son ampleur et se suffit à lui-même. C’est un changement complet de cadre.
Oui, et l’argent n’est qu’un outil formidable pour vivre des choses intéressantes et belles. Mais il faut accepter la notion de finitude. Le vrai problème de notre époque, c’est ce refus d’admettre que tout a une fin — la vie, une entreprise, un cycle. Naissance, croissance, mort : c’est le rythme naturel. Et chaque disparition enrichit l’écosystème.
Accepter la finitude, c’est ouvrir l’espace pour que la vie renaisse. Trouver sa voie, c’est justement ne pas se figer dans des dogmes.
"Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles mais uniquement par manque d'émerveillement."
Gilbert Keith Chesterton
Tout va se jouer dans les récits que l’on transmet. Si les jeunes s’identifient à une autre histoire, alors un autre monde devient possible.
Propos recueillis par Thérèse Lemarchand
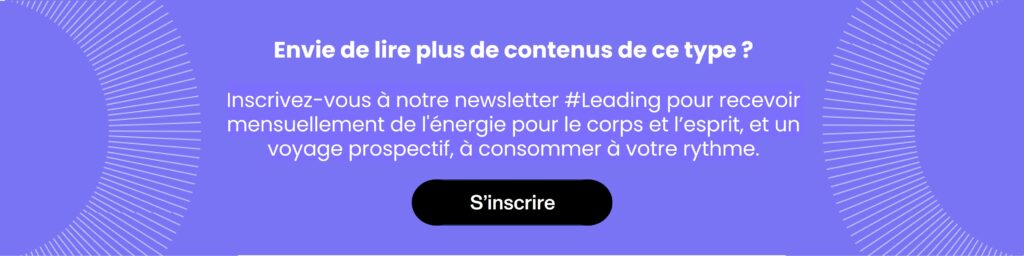
- Maison Landemaine. Site officiel de Maison Landemaine. Disponible sur : https://maisonlandemaine.com ↩︎
- Inmemori. (2024). Quelles sont les étapes du deuil ? https://www.inmemori.com/deuil/etapes-du-deuil ↩︎
- Wikipédia. (2025). Ikigaï. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ikigai [Consulté le 24 juin 2025]. ↩︎
- Lecostil. (2024). Site officiel de Lecostil – Conseil en leadership, coaching & stratégie humaine. https://www.lecostil.com/ ↩︎