🌸Beauté & créativité🖌️, retour sur notre Bulle Philo #5
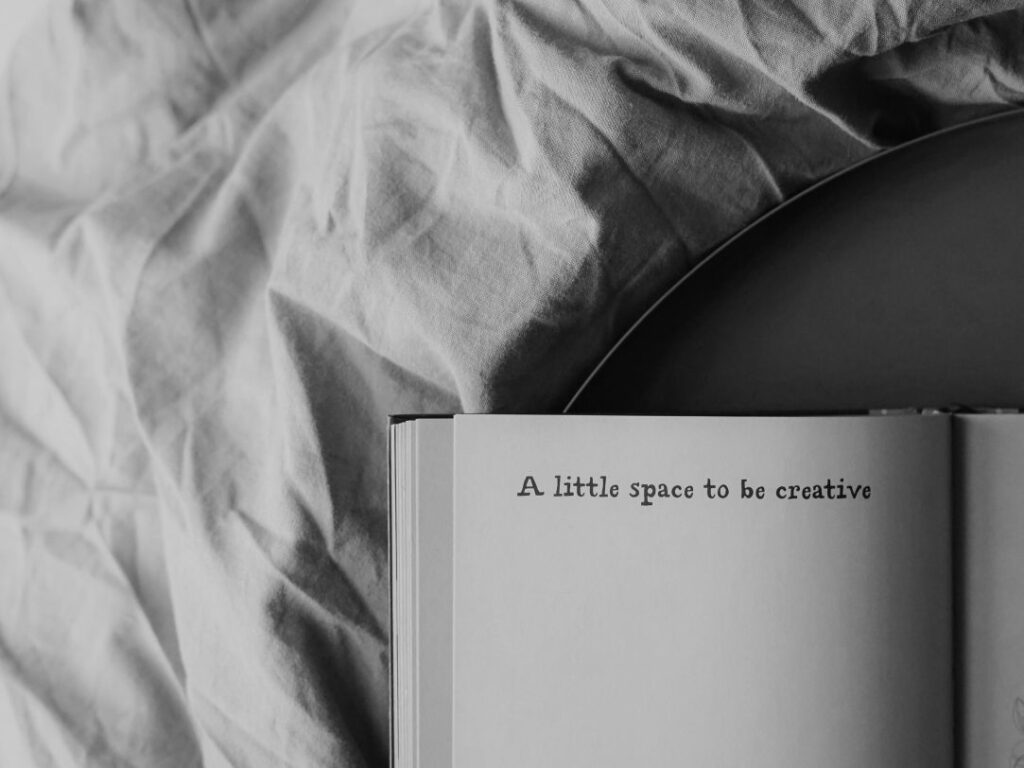
En tant que dirigeant, vous devez prendre des décisions, trancher, arbitrer, orienter, dans un emploi du temps contraint et être capable donc de percevoir le plus rapidement possible tous les enjeux du problème posé, à chaque fois.
Lorsque l’on a la tête dans le guidon, avec le souci de garder la trajectoire et d’embarquer tout le peloton sur le bon chemin, on est parfois frustrés de ne pas prendre le temps de regarder le paysage.
Regarder le paysage, c’est ce que nous vous proposons à travers ce texte.
Vous accorder le temps de faire un pas de côté puis de prendre de la hauteur pour penser la beauté et la créativité.
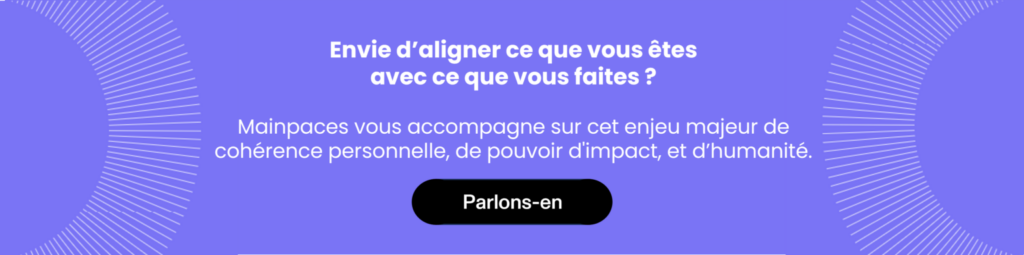
Introduction à la beauté
Qui a-t-il bien en commun entre la Joconde et une chaise dessinée par Philippe Starck ? Entre un paysage paradisiaque et un logo qu’une équipe de communication juge « esthétique » ? Nous recherchons tous le beau, nous nous en gorgeons, nous partons à se recherche, mais sans véritablement questionner notre rapport à lui.
🌎 Nous sommes dans un monde saturé d’images, un monde coloré et en mouvement permanent, un monde où les normes esthétiques et les modes changent à une vitesse folle, mais trop d’expériences visuellement fortes nous empêchent elles de vrais moments de contemplation ? Gravitent autour de cette notion, d’autres concepts souvent au cœur des réflexions managériales : l’imagination ou encore la créativité.
C'est le moment de vous orienter au cœur des grandes théories de philosophie de l’art : de l’agréable au beau, de la réception de l’œuvre d’art à la pratique et à l’exercice de notre créativité pour finir par les vertus de l’Art…
Commençons par le commencement, et en philosophie, c’est souvent synonyme de définition : qu’est-ce que le beau ?
Qu’est-ce que le beau ?
Première théorie : Quelqu’un ou quelque chose de beau correspond à un type idéal défini par un usage ou qui porte à un haut degré ses qualités intrinsèques : on parle de Belle voiture / Beau visage / Belle aquarelle. 💄
Mais saurons-nous, entre nous, nous mettre d’accord sur ce qui est beau et ce qui ne l’est pas ? et avec des personnes d’une époque ou d’une culture tout autres ?
Prenons l’histoire du visage et de la beauté féminine (vaste sujet…), on comprend vite que le beau possède une part relative : ça dépend des normes de l’époque.
- Au Moyen-Age : large front très dégarni



- Plus proche de nous : Il y a quelques décennies : sourcils épilés fins, là où aujourd’hui on dessine des sourcils très marqués…
Marlène Dietrich ou Edith Piaf versus Cara Delevigne1



Seconde théorie : Quelqu’un ou quelque chose de beau est ce qui nous procure du plaisir esthétique
Le basculement s’opère en tout cas dans la tête de nos philosophes au 18ème siècle. Avec la modernité, l’accent est mis sur l’expérience subjective du beau. Emmanuel Kant dit que le beau est « ce qui plaît universellement sans concept » : c’est selon lui LA spécificité du jugement esthétique, distinct de celui de l’entendement.
Pour comprendre cette définition, il faut simplement la découper en 3 segments :
❤️ « Ce qui plaît » : Kant remarque que le jugement de goût n’est pas un jugement de connaissance, mais plutôt un jugement de valeur qui me renseigne moins sur l’objet que sur la personne. Quand je dis que c’est beau, ce que j’indique en réalité c’est que l’objet me plait. Ce jugement de goût est subjectif : le beau est ce qui me plaît.
🌌 « Universellement » Avec l’ajout « d’universellement », on entre dans une forme de contradiction. Contrairement à l’agréable, ce qui caractérise le jugement de goût est le fait que lorsque je dis que cette chose me plaît, je prétends qu’elle devrait plaire à tout le monde. En d’autres termes, j’ai un jugement subjectif qui prétend à une certaine universalité. Le Beau, à la différence du bon ou de l’agréable, est un sentiment dont j’estime qu’il devrait être partagé par tous. Ce qui est beau est ce qui plaît, ce qui est subjectif, mais sans être pour autant relatif.
🕳️ Avec le « sans concept », c’est une seconde contradiction qui apparaît dans la définition du Beau. Je ne peux jamais démontrer pourquoi je trouve une chose belle. Je ne peux jamais trouver les raisons suffisantes qui expliquent mon jugement puisque ce dernier se fonde sur un ressenti. Le beau est ce qui plaît sans concept, c’est-à-dire sans raison essentielle au sens logique du terme.

C’est la raison pour laquelle nous sommes incapable de convaincre quelqu’un de la beauté de quelque chose.
La beauté, entre vérité et transcendance
Ce beau se trouve dans deux univers principaux : celui de l’art et celui de la nature, puisqu’il existe en effet bien entendu un beau dit « naturel » (mer, montagne, paysage, perspective d’une vallée…). Nous allons dans cette seconde partie examiner le rapport que le beau entretient à la vérité et à la transcendance, ce qui nous amènera à faire des différences entre le beau créé par l’homme et le beau naturel…
Pour ce qui est de celui créé par l’Homme, il a été défini par certains philosophes comme la manifestation d’une forme de vérité…
LECTURE 1 : Idée chez HEGEL2 : texte à lire « L’art nous met en présence de l’humain ».
Il y a donc aussi quelque chose à creuser du côté de la vérité. « C’est juste », « c’est exactement cela », « c’est tellement vrai » dit-on d’un passage de roman qui nous a particulièrement touché.
L’art nous donne accès à une forme de transcendance
🎨 Mais l’art va pour certains penseurs, encore au-delà. Allons franchir un pas conceptuel de plus : il est métaphysique. Le contact avec les Grandes œuvres nous transcende. C’est ce que vit de l’intérieur l’amateur, au sens premier du terme : celui qui aime, le mélomane, l’esthète… Il y a même à partir du 19ème siècle une religion de l’Art. Les penseurs romantiques voient dans l’art un medium pour dépasser sa petite condition humaine, la finitude, la mort.
🧞C’est aussi ce qui explique l’apparition de la notion de génie : le génie est celui qui dépasse toutes les règles esthétiques, les codes et les normes artistique parce qu’il est visionnaire, il crée pour la postérité, il est déjà dans l’avenir… C’est encore une représentation très ancrée dans nos imaginaires.
1.agréable, beau et sublime 🌷 : l’agréable est complétement subjectif, le beau est ce qui qui procure le plaisir esthétique et qui est universel, le sublime qui n’est pas forcément plaisant, au contraire :
« Est sublime ce qui […] prouve une faculté de l’esprit qui dépasse toute mesure des sens ».
Kant
💭 Le sublime révèle une faculté de penser, de concevoir. On a donc besoin d’imagination. Et la réponse à ce travail d’imagination est notre propre humiliation face à une telle grandeur. Nous nous sentons ridiculement petits face à la grandeur du sublime. Mais de cette confrontation le spectateur se rend compte de sa capacité à conscientiser la grandeur absolue. Le sublime ne vient pas du spectacle en question mais bien de notre manière de le ressentir. Dès lors, il semble que le sublime soit beaucoup plus simple à trouver dans la nature que dans l’art : une tempête, une montagne, …Il est bien plus simple d’être « humilié » par la grandeur de la nature que par le travail d’un autre être humain. Et très souvent, le sublime dans l’art est lui-même inspiré de la nature…. 🌳
2. artiste et artisan👩🎨 : ils ont de nombreux points communs :
- artiste et artisan produisent tous deux une œuvre singulière et originale ;
- tous deux suivent la production du début à la fin, contrairement à l’ouvrier qui n’a pas de rapport personnel avec ce qu’il est en train de produire ;
- leur production est faite selon les règles de l’art : tous deux doivent suivre une certaine méthode et respecter des techniques plus ou moins codifiées. On ne s’improvise pas plus musicien que menuisier : un apprentissage est nécessaire.
Mais les différences sont pourtant importantes :
- L’utilité ou non de l’œuvre produite : l’art est désintéressé
- L’originalité de la production : notion d’objet unique
- Le talent de l'artiste est au-delà du savoir-faire technique
La créativité : l’émergence du concept
L’art, le beau, nous les vivons, les ressentons, les appréhendons en allant au musée, en contemplant un paysage, en écoutant la voix d’une chanteuse qui nous bouleverse… Tout cela correspond au champ de la réception, mais nous avons aussi parfois besoin, ou envie, de nous confronter au beau autrement : en faisant :
= Poïen en grec : fabriquer, construire, faire ⚒️
= qui a donné « poïétique », et par extension « poésie » : « création, fabrication », « composition d’œuvres 🖌️
S’ouvre alors d’autres champs conceptuels : Celui qui écrit des poèmes, des chansons, celle qui crée un jardin, celle qui dessine à ses heures perdues, celui qui s’inscrit à un stage de poterie pour se confronter à la matière…
Deux pistes d’analyse :
- Le faire, le savoir-faire, la technique… du côté de l’artisanat, nous l’avons vu
- La créativité, c’est cette piste que nous allons privilégier

La créativité est la capacité à transcender les façons traditionnelles de penser ou d’agir, et à développer de nouvelles idées, méthodes ou objets.
Une notion nouvelle, emblématique de notre conception contemporaine de l’homme
🎭 La créativité ne suscite de l’intérêt que depuis les 80 dernières années.
La créativité n’a aucun sens avant, les œuvres d’art étaient considérées comme une imitation de la nature et non pas comme une forme de création, d’invention… Au Moyen-Âge, les idées créatives étaient perçues comme des inspirations divines, et si vous étiez à l’origine d’un truc génial, c’était Dieu qu’il fallait remercier d’avoir fait naître une telle idée en vous.
🕯️C’est au siècle des lumières que l’on commence à reconnaître la responsabilité des individus, bien que cela reste encore limité à l’imagination et à l’intelligence. Il faudra attendre les années 1920 pour voir émerger le concept de créativité, plus ou moins comme nous le connaissons aujourd’hui. La naissance de la psychologie à la fin du 19e siècle a été synonyme d’un changement de paradigme des cultures occidentales qui se sont alors davantage concentrées sur l’individu, la personnalité, et les capacités uniques de chacun.
= La créativité en tant qu’aptitude ou trait de caractère est devenue populaire avec le livre de Graham Wallas L’Art de penser. Dans cet ouvrage, l’auteur présente un modèle3 pour illustrer la manière dont les hommes abordent les problèmes et font preuve de créativité. C’est ainsi que le concept de créativité est né. Depuis, la psychologie et les sciences humaines en général ont continué de le développer, jusqu’à aboutir à l’idée que nous en avons de nos jours.
- C’est une capacité. Si elle semble naître naturellement chez certains, tout le monde peut développer sa créativité moyennant le temps et les efforts nécessaires.
- Elle transcende les façons de penser ou d’agir traditionnelles. Un poète qui nous montre le réel comme nous ne l’avons jamais vu, un écrivain capable d’écrire une page sur l’Amour au-delà de tout ce qui a déjà été dit sur le sujet…
- Elle développe des choses nouvelles et originales. Le mot clé ici est « développer » :
- S’il s’agit d’une idée, cela signifie la confronter au monde pour la vérifier.
- S’il s’agit d’un processus, cela signifie tester son fonctionnement.
- S’il s’agit d’un objet, il faudra le “créer”, c’est-à-dire le fabriquer.
En ce qui concerne la créativité, les chercheurs en neurosciences ont identifié4 trois grands réseaux :

- Le réseau d’attention exécutive : nous aide à prêter attention et à nous concentrer
- Le réseau de l’imagination : nous permet de rêver un peu ou de nous imaginer dans la peau de quelqu’un d’autre
- Le réseau de saillance : nous permet d’identifier quand les choses que nous avons enfouies au fond de notre cerveau deviennent saillantes dans le monde qui nous entoure
Plus ces réseaux sont actifs dans notre cerveau, plus ils échangeront entre eux, et plus nous serons créatifs ! 🧠
Créativité et intelligence : existe-t-il un lien ?
En 1999, les chercheurs Sternberg et O’Hara ont fourni un cadre5 de cinq relations possibles entre créativité et intelligence :
- La créativité est une forme d’intelligence
- L’intelligence est une forme de créativité
- La créativité et l’intelligence sont deux constructions distinctes qui partagent des traits en commun
- La créativité et l’intelligence font toutes deux partie de la même construction et sont en quelque sorte la même chose
- La créativité et l’intelligence sont deux constructions distinctes sans aucun lien l’une avec l’autre
Certaines études ont mis en évidence chacune de ces hypothèses, mais aucune d’entre elles ne permet de conclure à une théorie plus qu’à une autre. Donc rien ne prouve que si vous êtes plus intelligent que la moyenne, vous êtes également plus créatif. Mais rien ne prouve le contraire non plus !
Cette notion est surtout étudiée en psychologie et en neuroscience, ce qui m’intéresse ici c’est qu’elle a un fondement en philosophie : l’imagination. 💭
LECTURE 2 : Texte de bachelard : n°208 p 338.

Les vertus de l’art ou quand l’art régénère / retour à l’universel
De là nous pouvons dégager 3 constantes :
- L’art impose un ici et maintenant : il instaure un rapport au temps inédit et d’une qualité rare… Ce qui est ô combien précieux dans notre modernité, ère de zapping, de l’inattention, de la rapidité. Le rapport à l’art nous ancre dans le présent, que ce soit dans la réception (je suis absorbée par la musique que l’écoute dans mon casque) ou production (ma pratique du dessin me plonge dans un état quasi méditatif). 👇
- L’art nous invite à nous extraire de notre condition et à nous élever au -delà. Il voisine, de ce fait, avec la religion, la métaphysique, la spiritualité. ⛪
- L’art a des bienfaits que l’on commence seulement à toucher du doigt, grâce à neurosciences, notamment, je prendrai pour conclure, deux exemples de référence sur la musique. 🎻

LECTURE 3 : Le pansement Schubert :
La violoncelliste Claire Oppert, ayant mis en place un protocole médical pour soulager la douleur et l’anxiété des patients : extrait de son livre, témoignage à lire P 9 à 11.
LECTURE 4 : Les effets de la musique ou l’accord entre musique et neurosciences
Emmanuel Bigand est musicologue, titulaire de la Chaire Musique Cognition Cerveau de L’institut Universitaire de France, chercheur associé à l’Orchestre Dijon Bourgogne :
Présentation à lire ci-dessous :
La science est aujourd'hui capable de comprendre l'effet de la musique sur le cerveau, c'est-à-dire qu'il est possible de suivre le parcours du son, de l'oreille jusqu'au cerveau, et de voir grâce à l'IRM, les effets que les sons produisent. On se rend compte que la musique modifie les mécanismes biochimiques du cerveau : elle active, par exemple, la production de dopamine, un neurotransmetteur essentiel au fonctionnement du cerveau car il contribue à sa plasticité, et... qui nous fait vibrer. En stimulant la plasticité cérébrale, la musique permet de restaurer notre réseau de neurones. Elle peut agir dans les cas de traumatismes crâniens, de maladies de parkinson ou encore d'aphasies. Des personnes qui ne parlent plus se mettent à chanter, des malades de Parkinson retrouvent le plaisir de la danse, tandis que chez les patients souffrant d'Alzheimer, se souvenir d'une mélodie entendue jadis peut réactiver la mémoire. Autre découverte des neurosciences : la musique en « pansant » les neurones, prémunit du vieillissement et des atteintes cérébrales.

Des recherches sont en cours actuellement, nous nous réjouissons, par exemple, que des chercheurs soient maintenant associés à des Orchestres … pour expérimenter, en direct !
Conclusion
Nous sommes partis de deux théories du Beau :
- Le Beau comme ensemble de qualités intrinsèques (tels les Grecs anciens qui recherchaient dans le corps de l’athlète sculpté dans le marbre les proportions parfaites)
- Le Beau comme ce qui procure du plaisir esthétique (changement de perspective, regard porté sur la réception de l’œuvre d’art et ses effets)
Ces deux définitions canoniques correspondent : la première, à la définition antique et, la seconde, à une définition moderne, notamment kantienne. Mais les théories philosophiques du 19ème nous apprennent que l’Art nous emmène dans des contrées plus profondes.
Elles font le lien entre :
- art et vérité
- art et transcendance.
C’est à ce stade que nous avons souhaité faire rentrer le concept de créativité, beaucoup plus moderne et non spécifique à la philosophie. La créativité ouvre un champ théorique à la croisée des science cognitives, des science humaines, des neurosciences… et elle a le mérite de nous faire passer de l’observateur, de l’auditeur, du spectateur qui reçoit le Beau et celui d’acteur, de créateur.
Chacun est encouragé à exercer sa créativité…
Aujourd’hui valorisée dans les entreprises, sans que la plupart du temps elle soit précisément définie, elle permet de mettre le doigt sur plusieurs idées clés :
- C’est une capacité.
- Elle transcende les façons de penser ou d’agir traditionnelles.
- Elle développe des choses nouvelles et originales

Bonne nouvelle : la créativité n’est pas un don magique dont seuls quelques heureux individus peuvent bénéficier. Elle peut être nourrie et développée.
En philosophie, nous préférons le concept d’imagination. C’est Bachelard qui dit que ce qu’on entend par créativité aujourd’hui correspond à de l’imagination appliquée… mais nous pourrons en reparler !
Subjectivité, relativisme, usage erroné des notions, représentations inextricablement liée aux idées reçues d’une époque… Ce sont finalement les vertus de l’Art (avec un grand A) qui nous font sortir de cet écueil et tendre vers une forme d’universel :
- L’art impose un ici et maintenant / rapport au temps précieux → équilibre
- L’art nous invite à nous extraire de notre condition et à nous élever au -delà.
- L’art a des bienfaits que l’on commence seulement à toucher du doigt, grâce à neurosciences.
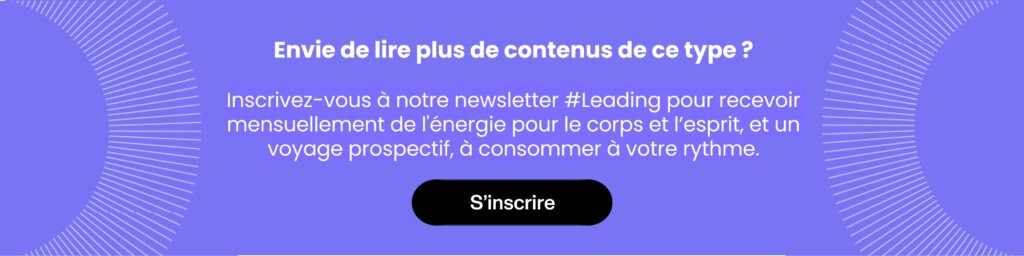
- Marie Claire. (s.d.). Cara Delevingne, mannequin et it-girl. Disponible sur : https://www.marieclaire.fr/,cara-delevingne-mannequin-et-it-girl,20291,689033.asp ↩︎
- HEGEL texte sur l'art (Extrait de l'Esthétique) ↩︎
- Popova, M. (2013). The Art of Thought: Graham Wallas’s Stages of the Creative Process. The Marginalian (anciennement Brain Pickings). Disponible sur : https://www.brainpickings.org/2013/08/28/the-art-of-thought-graham-wallas-stages/ ↩︎
- Haridy, R. (2018). Study offers fascinating insight into the brain's creative thought process. New Atlas. Disponible sur : https://newatlas.com/creative-thought-brain-activity-networks/53025/ ↩︎
- Amabile, T. M. (1998). How to kill creativity. Harvard Business Review, 76(5), 76–87. Disponible sur : http://psycnet.apa.org/record/1998-08125-013 ↩︎